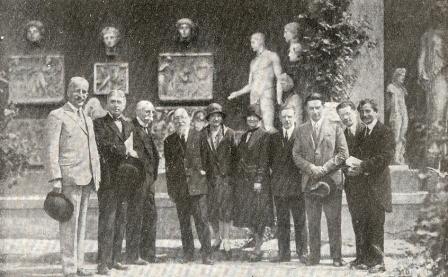FEC - Folia Electronica Classica
(Louvain-la-Neuve) - Numéro 14 - juillet-décembre 2007
Antoine Meillet,
l’Europe et les études classiques
par
Jean Loicq
Professeur honoraire de
l’Université de Liège
Adresse : avenue Nandrin, 24 -- B
4130 Esneux
<loicq-berger@skynet.be>
[Article déposé sur
la Toile le 14 juillet 2007]
Le texte
qu'on va lire est une adaptation de l'article paru sous le titre
Meillet et l'Europe dans le Mémorial publié par les
Studia Indo-Europæa
de Bucarest (t. 3, 2006). Ce dernier comporte en outre d'importants
compléments à la bibliographie de ce grand linguiste parue en 1937 dans le Bulletin de la Société de
linguistique de Paris (BSL) et, pour répondre à un vœu souvent exprimé, un
aperçu de son œuvre critique, où se trouvent semées beaucoup d'idées. La seconde
partie du Mémorial recense
plusieurs centaines d'études et de témoignages sur l'homme et la doctrine : cette dernière reste, en effet, au centre de réflexions historiques ou
méthodologiques, ainsi qu'en témoigne encore le recueil
Meillet aujourd'hui, paru à l'automne 2006 (Louvain, Peeters, 312 p.).
Rappelons
ici qu'Antoine Meillet (1866-1936), reçu premier à
l'agrégation de grammaire de 1889, suppléait aussitôt à l'École des hautes études de la
Sorbonne son maître Ferdinand de Saussure (1857-1913), retrouvant à la rentrée, de l'autre
côté de la table, ses compagnons d'études de la veille. Il devait succéder
à Saussure deux ans plus tard et, en 1906 – centenaire célébré par le
Mémorial –,
il obtenait la chaire du Collège de France occupée jusque-là par Michel Bréal (1832-1915), le créateur de
la sémantique. Il devenait ainsi le secrétaire en titre de la Société de
linguistique à laquelle il allait, comme à son double enseignement, assurer un
rayonnement mondial. En 1924, il entrait à l'Institut
qui, en 1936, lui décernait, toutes académies réunies, sa plus haute récompense : le prix Osiris.
Le rayonnement d'un maître se mesure aussi au nombre et à la notoriété des
élèves qu'il a formés, voire orientés dans leur carrière. De
l'helléniste belge Boisacq, l'un de ses premiers auditeurs, jusqu'au
promoteur de la linguistique fonctionnelle, André Martinet, récemment disparu,
en passant par Vendryes, son disciple le plus fidèle par l'esprit, Marouzeau, Marcel Cohen,
Kuryłowicz, Benveniste (qui ont tous deux
renouvelé notre vision de l'indo-européen), Chantraine, Lejeune et tant d'autres, c'est un chapitre
entier de la linguistique et de l'orientalisme en Europe qui porte sa marque.
La célébrité
de Meillet tient avant tout à ses travaux de synthèse : les uns consacrés à
l'indo-européen en général, les autres aux grandes langues de la famille, de
l'iranien au germanique, mettant en relief leurs développements spécifiques et
les traits qui fondent leur individualité. C'était là, à proprement parler, le but
qu'il assignait à sa discipline, de préférence aux reconstructions théoriques où
se complaisait la vergleichende Sprachwissenschaft du XIXe siècle : de
l'avis général, son œuvre n'en a que mieux résisté à l'épreuve du temps. En
mettant en avant le rôle de la société – et donc de l'histoire – dans le
développement du langage, il élevait la linguistique au rang d'un véritable
humanisme et posait les premiers fondements de l'actuelle sociolinguistique.
Mais en même temps, l'attention qu'il a portée aux systèmes des langues qu'il
étudiait faisait de ce disciple
de Saussure l'un des précurseurs de la linguistique structurale, attentif même,
vers la fin de sa vie, aux travaux de N. Troubetzkoy, R. Jakobson et A. Martinet. On va voir d'ailleurs que son infatigable curiosité n'allait pas
qu'au passé des langues. Mais on verra aussi que dans l'Europe des nationalités née de la Grande
Guerre, il faisait une place centrale à la culture gréco-latine, dans laquelle il
voyait un indispensable facteur d'union.
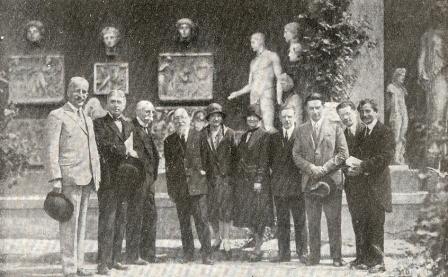
Un groupe de savants
français et étrangers au Musée
archéologique de Florence (1928).
De gauche à droite : Max Niedermann,
Alfred Ernout, Emile Mâle, A. Meillet, Mme Meillet, Mme ?, Carlo Battisti,
Giacomo Devoto, Émile Benveniste, Albert Grenier (d’après Atti I
Congresso di studi etruschi)
Un
savant hors de la tour d'ivoire
Sans avoir été ce que, après 1945, on a appelé un intellectuel engagé, Meillet,
comme nombre de professeurs de sa génération, n'a pas cru devoir tourner le dos
aux événements dont il a été le témoin. Conscient de l'incapacité où il était
d'agir directement sur eux, il estimait qu'il appartient au savant d'éclairer
les hommes dont c'est la tâche. Et ce n'est pas sans surprise qu'un chercheur
d'aujourd'hui découvre de quel crédit ont pu jouir auprès des autorités et du
public, durant la grande crise de 1914-1918, quelques universitaires à qui leurs titres scientifiques apparaissaient conférer
des compétences de tous ordres.
Or, parmi les travaux
de Meillet omis dans la bibliographie citée plus
haut, il est nombre de publications de circonstance qui témoignent de son effort de coopération à la lutte
engagée par la France et ses alliés en guerre et, une fois celle-ci achevée, de
ses démarches pour faire aboutir certaines causes qui lui étaient chères. Il n'est pas, en effet, jusqu'au
traité de Versailles qu'il n'ait indirectement contribué à préparer, on va le voir, en sa qualité de linguiste attentif aux problèmes des nationalités.
C'était pour lui, qui occupait une chaire en vue, une manière d'étendre son enseignement jusqu'aux sphères mêmes du pouvoir.
Comment ce savant
a-t-il été conduit à une certaine forme d’action publique, lui dont
l’enseignement et les travaux de recherche auraient pu absorber les forces de
plusieurs travailleurs, qui, contrairement à plus d'un de ses collègues, entendait se tenir à
l’écart de tout mouvement politique, qui se déclarait même souvent déçu
par les faiblesses de la IIIe République ? La réponse à cette
question doit faire intervenir plusieurs facteurs.
L’homme, d’abord. On
se souvient de lui comme d’un « moine laïc », dans sa campagne du Berry surtout, où il
se retirait l’été pour composer ses livres, ne sortant de chez lui que pour de
brèves promenades conduites d'un pas rapide, un journal sous les yeux ; mais son
ouverture d’esprit, soulignait-on aussi, dépassait de beaucoup les
frontières de l’Hexagone, avec toutefois une conscience aiguë de la
mission humaniste de la France. Assidu à nombre de sociétés scientifiques, qu’il fréquentait
activement dans le but d'enrichir sa discipline, il a été, avec le temps, de
plus en plus présent dans les commissions ou les comités où ses rapports et ses
avis étaient sollicités, à Paris et à l’étranger. On réalise alorscombien ce
chef de l’école linguistique française a conçu son rôle avec abnégation et
générosité, à la manière plutôt d’un apôtre laïque.
D’ailleurs, il ne
faudrait pas réduire le portrait intellectuel de Meillet à celui d’un
grammairien à l’affût des archaïsmes du sanscrit védique, du grec d’Homère ou
des parties versifiées de l’Avesta. Un spirituel collaborateur des
Nouvelles littéraires qui l’avait interviewé en 1924, Frédéric Lefèvre,
notait ceci : « Un savant de cette sorte n’est pas ce qu’un vain peuple pense :
un monsieur tout habité d’étranges manies et de tics, protégeant, d’une antique
calotte de velours, un chef dénudé, et vivant au milieu de la poussière
d’innombrables in-folio. M. Meillet est un homme gai, alerte, l’esprit vif et
l’intelligence toujours en éveil. Il se repose de la rédaction d’un article de
philologie arménienne en lisant la N.R.F., la Revue Musicale, les
Nouvelles littéraires ou L’Europe nouvelle. Rien de ce qui est
moderne ne lui est étranger » (repr. dans F. L., Une heure avec...,
3e série, Paris, 1925, p. 31-32).
Il faut aussi rappeler
que Meillet a été, dès sa prime jeunesse, un voyageur et un marcheur d’une
endurance surprenante ; lui-même racontait comment, un été, son arrivée en Corse
avait coïncidé avec une grève des chemins de fer départementaux, le contraignant
à accomplir à pied l'itinéraire prévu. Mais très vite sa curiosité d’humaniste et d’homme
de science l’avait conduit à l’étranger, en Italie surtout où, me disait Mme
Meillet, l’amateur d’art qu’il était − et très myope de surcroît − se faisait
apporter une échelle pour examiner les fresques des vieilles églises d’Ombrie ou
de Toscane. Son intérêt pour la langue et la civilisation arméniennes lui avait
fait obtenir, à l’âge de vingt-cinq ans, une première mission à Vienne, au
couvent des PP. Mekhitharistes, et en Arménie même, au cœur de la congrégation,
à Etchmiadzin près d’Erevan ; les moines, un peu effarouchés par la hâte fébrile
que manifestait leur jeune hôte à se faire communiquer des manuscrits − ces moines qui avaient l’éternité devant
eux l’appelaient « Monsieur Vite-Vite » (Vaghvaghaki).
Une
deuxième mission arménienne
(1903) lui avait fait traverser de part en part la Russie, de Saint-Pétersbourg
à Bakou. Spécialiste du vieux-slave, il avait une certaine pratique des langues
modernes et était, depuis ses années d'étudiant, lié d'une étroite amitié avec
Paul Boyer (1864-1949), futur administrateur et réformateur de l'École des
langues orientales. Ce dernier tenait de longs séjours à Moscou et de ses
passages à Jasnaja Poljana, auprès de Tolstoï, une connaissance intime de la vie
russe et, bien qu'ennemi du tsarisme, suivait avec inquiétude l'évolution
politique du pays. Meillet n'ignorait rien de l'activité de son aîné, en qui il
voyait associer recherche savante et observation de l'actualité étrangère.
Ce goût des voyages,
cette tournure d'esprit internationaliste que j'ai plus tard retrouvée chez Mme
Meillet mais qui était si rare en France à cette époque, allaient trouver à s'exercer après la guerre surtout, alors que sa notoriété eut désormais
franchi les frontières.
Une linguistique ouverte sur
l'histoire et la sociologie
Au-delà de ces
contingences d’ordre personnel, c’est la conception même que Meillet s’était
faite de la linguistique qui l’a conduit à la sociologie et de là, à l’histoire.
De Bréal il avait appris à ne jamais séparer la langue et les hommes qui
l’emploient. Le maître s’était assez tôt détourné de la technique de la
grammaire comparée pour mettre en lumière, dans les grandes langues de
civilisation, l’action de l’homme, de sa culture et de son histoire. De son
côté,
Saussure pressentait que toute langue, prise à un moment donné de son
développement, constitue un système particulier, une architecture − ce sont les
prémisses de la linguistique structurale − et l’essentiel de l’œuvre de Meillet,
on l'a vu, a consisté à faire ressortir comment, à partir du commun modèle
préhistorique, quelques grandes langues indo-européennes ont acquis, en évoluant
séparément, l’aspect qu’elles présentent à l’époque des premiers textes.
Comment
cette architecture vient-elle à se modifier avec le temps ? est-ce la structure
même de la langue qui porte en soi les lignes directrices de son évolution ?
ou sont-ce, au contraire, les éléments qui, se modifiant sous l'action
d'influences externes, entraînent à la longue un changement de structure ? vieux
et vif débat, nullement clos, auquel ont pris part depuis des linguistes en
partie formés à son école, comme J. Kuryłowicz ou A. Martinet. Il est sûr que, sans
nécessairement se sentir « tiraillé »,
ainsi qu'on l'a dit, entre histoire et structure , Meillet a
cherché un équilibre entre les deux points de vue ; mais, historien plus que
théoricien (ainsi s'est-il défini un jour), il était personnellement tourné
davantage vers la diachronie, et vers ce qui, dans la diachronie, lui paraissait
relever de l'évolution des sociétés et des mentalités.
Il concevait, d'après des
survivances védiques ou homériques, un indo-européen tout dominé par des
conceptions de
« demi-civilisés » (émule de Durkheim et de Lévy-Bruhl, il évitait
le terme de
« primitifs »), et évoluant avec les progrès de la civilisation vers
des langues comme le grec classique,
qui éliminait les catégories concrètes comme le duel ou le locatif et où
prévalaient les
valeurs rationnelles et laïques de mots autrefois chargés de religiosité. Dans
cette perspective, il opposait volontiers le
grec au latin (ou au sanscrit) : en regard du neutre húdōr, témoin
d'une conception purement matérielle de l'« eau », seul conservé par le grec, aqua exprime une
notion conçue comme féminine de l'eau vive, voire curative (cf. Aquae et les
Âpas védiques), tandis qu'avec le même radical dont est fait húdōr
le latin créait un mot unda
également
« animé », auquel son infixe -n- confère une
valeur quasi-verbale, donc active
– celle-là même
qui survivait en sanscrit dans le verbe véd. unátti
« il se
meut dans l'eau » (pl. undánti). Il voyait dans le couple ignis
:
pũr une opposition parallèle,
attribuant à des développements inégaux des mentalités le maintien du nom
« animé » dans des langues archaïques comme le lituanien (ugnis)
et le slave (russe ogón'), et
même sous forme divinisée dans
l'Inde (Agni).
Passant de faits de détail
aux caractères généraux de la langue, il voyait dans la partie la plus largement
conservée de l'indo-européen l'idiome d'une aristocratie conquérante et
organisatrice, mais sans unité politique, chaque petit groupe ayant son
autonomie. Le grec ancien lui paraissait tenir de là sa physionomie propre, qu'il opposait aux traits populaires du latin, langue archaïque certes, mais de
propriétaires paysans. Sur un autre plan, il comparait aussi le grec au turc, à la structure si régulière, où
chaque catégorie grammaticale a une caractéristique unique, toujours la même
dans tous les cas, en contraste total avec la morphologie compliquée du grec ; il
notait encore la différence entre ce dernier et le sanscrit classique, dont les formes verbales, qui
seules définissent exactement l'action, sont comme étouffées par l'envahissement
de la composition nominale, alors que le verbe grec se déploie en catégories
bien arrêtées, chaque racine ayant pour ainsi dire son propre système. Ainsi
conclut-il une communication sur les Caractères généraux de la langue grecque,
que les hellénistes peuvent encore méditer : « la langue grecque offre deux
caractères qui se manifestent également dans la politique, dans l'art et dans la
littérature : une individualité accusée de chaque élément, et des lignes
nettement dessinées, des catégories exactement définies, mais qui ne s'emboîtent
pas les unes dans les autres » (C. r. de l'Acad. des inscr., 1928, p.
10-13).
Sans doute la doctrine se bornait-elle à un nombre
limité de constats de ce genre, et son principe même a-t-il fait l'objet de
discussions. On entre là, il est vrai, dans un domaine délicat, où il
apparaît bien malaisé d'établir des rapports de nécessité. D'ailleurs, disciple
de Saussure, Meillet était aussi l'héritier de Bréal, et se défiait des
constructions théoriques abstraites.
Il reste que ses
travaux ont tôt attiré l'attention d'historiens d'orientation sociologique. Lucien Febvre consacrait
à l'Aperçu d’une histoire de la langue grecque, dès sa parution, un article enthousiaste, souvent réimprimé
depuis (Combats pour l'histoire, p.
158-168) ; trente ans plus tard, il s'assurait sa collaboration à la section des
sciences humaines dans l'Encyclopédie française d'Anatole de Monzie.
Si l'on pouvait prévoir que Camille Jullian, le fougueux historien de la Gaule,
s'appuierait sur les travaux
de Meillet dans sa vision de la préhistoire européenne, on n'est pas peu
surpris, en revanche, d'apprendre qu'un autre
maître de la « nouvelle histoire », Marc Bloch, s'est inspiré de vues
convergentes de Meillet et de notre Henri Pirenne
dans ses recherches d'histoire rurale (Combats..., p. 395).
La
linguistique de Meillet n'est en effet pas seulement historique
– tout en préparant
la voie à la linguistique synchronique naissante
–
, elle est aussi, par
un trait qui lui appartient en propre, sociologique : « Les caractères d'extériorité à l'individu et de
coercition par lesquels
Durkheim définit le fait social apparaissent donc dans le fonctionnement du langage avec la
dernière évidence », écrivait-il dès 1905-1906 (repr. dans
Linguistique historique et linguistique générale, I, p. 230). Dès
auparavant, le neveu de
Durkheim, Marcel Mauss, qui devait diriger plus tard le groupe des ethnologues
français,
s'était mis à l'école de Meillet et devait écrire à sa mort des pages
qui débordent de reconnaissance (L'Année sociologique, 1938). On verra de
même plus tard son
propre disciple Claude Lévi-Strauss s'inspirer de Jakobson :
l'anthropologie structurale sortie de ces rencontres a ainsi des racines
lointaines dans la linguistique sociologique de Meillet, comme le reconnaît
Lévi-Strauss lui-même (cf. p. ex. Anthropologie structurale, I [1958 ;
réimpr. 1971], p. 266).
Si donc en dernière
analyse l’histoire, pour Meillet, se révèle la seule variable susceptible de
rendre compte de l’évolution des langues parmi les divers paramètres dont
relève le langage (anatomiques, psychiques, etc.)
– variabilité dans le temps
–, ce sont les
conditions sociales où la langue est placée à une époque déterminée qui expliquent sa variabilité dans
l'espace (les dialectes) ou dans la hiérarchie sociale (les niveaux de langue). C’est en historien en même temps
qu’en linguiste-sociologue (nous dirions aujourd'hui : en sociolinguiste)
que Meillet, avec la maturité, observe désormais l’évolution politique et
sociale de l’Europe depuis l’Antiquité jusqu’aux soubresauts annonçant la
Première Guerre
mondiale et les révolutions qui en ont marqué le terme.
L'Europe en
crise
La guerre de 1914 a
été en effet pour cet intellectuel libéral et progressiste, qui avait entretenu des
relations cordiales avec nombre de collègues allemands et autrichiens, qui
venait de composer en allemand un manuel d’arménien classique, un déchirement
cruel. Elle trouvera en lui un observateur passionné, inquiet, certes − fin
décembre déjà, un ami qui enseignait la littérature russe en Sorbonne note que
Meillet déplorait le peu de combativité des troupes russes, − mais un
observateur qui nourrissait aussi l’espoir de voir une Europe nouvelle, plus
démocratique, s’élever sur les décombres des derniers empires absolutistes.
Aussi voit-on le linguiste, par une collaboration assidue
à des revues destinées à un public éclairé mais large, comme la très
internationale Scientia, préoccupé des rapports entre langue et nationalité,
de la situation linguistique des empires de Russie (spécialement
dans les Pays baltes), d'Autriche, de l'Asie ottomane.
Ces travaux d'approche
préparent l'essai sur Les langues dans l'Europe nouvelle, paru
quelques semaines avant la fin du conflit mais composé alors que l'issue en était
encore incertaine, et qui proposait pour une Europe nécessairement différente une politique
linguistique courageuse, hardie, mal accueillie dans certains pays. On y
reviendra plus loin.
En attendant, les
événements se succèdent, avec leur cortège de malheurs, et la douleur de voir
basculer dans le camp ennemi, après des atermoiements, des pays comme la Grèce
ou la Bulgarie.
Présidant en 1917 l’Association des études grecques, Meillet ne craint pas de
dénoncer la politique de neutralité bienveillante à l’égard de l’Allemagne
pratiquée par le gouvernement de Constantin Ier, beau-frère de Guillaume
II ; et il prend soin de saluer dans une note de correction la venue au pouvoir d'E. Venizelos
et l’entrée de la Grèce dans le camp des Alliés (Rev. des études grecques,
30 [1917], p. xi).
Meillet devait
mettre son humanisme au service de certaines causes où la justice
internationale, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes étaient en jeu.
On a dit plus haut l’affection qu’il avait conçue,
dès son premier séjour dans le pays, en 1891, pour la culture et la langue arménienne.
Il ne se résignait pas à considérer ce pays, christianisé dès avant Constantin
le Grand, comme une province parmi d'autres de la grande Asie : « les Arméniens... ont reçu, rappelait-il, la civilisation occidentale à peu près dans les
mêmes conditions que les peuples de langue germanique et de langue slave » (La
Voix de l'Arménie, 1 [1918], p. 11). Il relevait aussi dans le vocabulaire
militaire de l'arménien quelques termes issus de l'éphémère protectorat
exercé par Rome sur cette contrée, éternel enjeu d'impérialismes adverses (Mém.
de la Soc. de linguistique, 18 [1913], p. 348-350).
Au
lendemain des massacres de 1915,
il s'est dépensé en faveur de la cause arménienne, affirmant par la parole et
par la plume sa foi dans l’avenir de la nation, exposant, en termes sobres mais
avec toute son autorité de spécialiste, les titres à constituer un État
autonome que lui confère son brillant passé. « Comme le
retour de l’Alsace-Lorraine à la France, écrit-il en 1918, la libération de
l’Arménie symbolisera le triomphe des principes au nom desquels combattent les
Alliés et pour lesquels les États-Unis sont entrés dans la guerre »
(Bull. de l'Alliance française, suppl. au n° 79, p. 4). À l’approche de la conférence de
Lausanne, en 1923, Meillet joignait sa signature à celle d’éminentes
personnalités du monde politique, scientifique et littéraire, comme Georges
Clemenceau, Paul Langevin ou Anatole France, dans un appel solennel à la diplomatie
internationale pour que la cause de l’Arménie trouve enfin une solution conforme
aux droits élémentaires de l’humanité. En dépit de la cruelle désillusion que
devait lui infliger le honteux traité de Lausanne, qui abandonnait l’Arménie
aux ambitions de l’U.R.S.S., Meillet est resté jusqu’au bout fidèle à sa
vocation arménophile. L’été 1936 encore, il a trouvé la force de dicter un message à
l’occasion du 1500e anniversaire de la traduction arménienne des
Évangiles, où il en réaffirmait la portée et la signification pour la science et
pour la culture.
Des documents peu
connus attestent, chez Meillet, un rôle quasi officiel et davantage permanent.
Membre du Comité
directeur de l’Alliance française, il consacrait dès 1916-1917 une partie de son
énergie au Bulletin de guerre que l’Alliance entendait diffuser dans les
pays neutres, où l’on savait la propagande allemande active et même efficace :
cette collaboration était en grande partie anonyme, mais il m’a été possible de
l’identifier en explorant ses papiers conservés au Collège de France. Si l’on
reconnaît la griffe du maître dans les articles consacrés au problème des
nationalités en Europe centrale, à l’avenir du français dans la diplomatie
européenne, aux prétentions allemandes sur les peuples slaves et baltiques, on
est davantage étonné d’apprendre
– par son propre
témoignage –
qu’il a assumé deux fois par mois la tâche de dresser le tableau de la situation
militaire (voir le Bull. de l'Alliance française, 37 [1915-1920], p.
12-16). On s'explique ainsi que l’historien Ernest Lavisse, préparant ses Lettres à tous
les Français (1916) sur les poids respectifs des forces en présence dans le
conflit, ait confié à Meillet, promu ainsi au rang d’expert militaire, la tâche
d’évaluer les chances de l’armée russe (c’était avant la triste paix de
Brest-Litovsk) et de l’armée italienne.
Son action a pris un
tour plus résolument
diplomatique dans les mois qui ont précédé la conférence de Versailles. On sait
qu'à la veille de la
Grande Guerre, le Quai d’Orsay, accoutumé à ne traiter qu’avec les grandes
puissances, ignorait à peu près tout des nationalités et des cultures dont elles se
composaient : Pologne, nations baltiques, nations slaves d’Europe centrale,
etc. Aussi, au lendemain de l’armistice, lorsqu’il fallut jeter les bases de la
nouvelle Europe, un Comité d’études politiques créé par le
Ministère des Affaires étrangères chargea Meillet de composer deux
rapports : l’un sur l’Arménie, l’autre, sur la Pologne et la Lituanie. De
là deux opuscules enfouis dans l'énorme liasse des imprimés relatifs aux
conférences de la paix, mais auxquels l'Europe d'aujourd'hui confère curieusement une actualité
nouvelle, conforme aux réalités ethno-linguistiques qui y sont décrites.
Vers une Europe
nouvelle sous le signe de l'humanisme classique
Dans
Les langues dans
l’Europe nouvelle (automne 1918), l'auteur examine avec perspicacité l’ensemble de la
situation du Vieux Continent. Contrairement à ce qu'ont cru ou voulu
croire certaines critiques, il souhaitait sincèrement l'émancipation de beaucoup de peuples jusque-là
opprimés ; la citation suivante, peu connue, ne laisse à cet égard aucune ombre :
« Il faut que les nations slaves de l'empire austro-hongrois soient libres. Il
faut que la Pologne recouvre son indépendance. Il faut que les Italiens
d'Autriche soient réunis à l'Italie. Il faut que les Roumains de Transylvanie
soient réunis à la Roumanie » (Bull. de l'All. française, n° 78 [février
1918], p. 5). En même temps, toutefois, il se déclare préoccupé par le
morcellement linguistique consécutif à l'avènement des États nés de la victoire,
démocraties mettant au pouvoir des intellectuels au service des classes moyennes et
paysannes, aspirant à promouvoir comme langues de culture des idiomes en partie
construits artificiellement sur des parlers paysans, donc sans grand passé
littéraire et sans diffusion internationale. Meillet pensait qu’il y avait là pour l’Europe un
danger d’éclatement, une dispersion d’efforts qui, sans dispenser personne
d’apprendre de grandes langues, aurait, au point de vue scientifique,
l’inconvénient d’étouffer partout les dialectes authentiques.
Ainsi, il porte dans la deuxième édition de ce livre (1928) un jugement sévère
sur le nationalisme linguistique de la nouvelle république d’Irlande :
« Le linguiste peut de loin regarder avec curiosité l’expérience que fait l’Etat
libre d’Irlande en essayant de rendre vie au gaélique moribond. Il n’ignore pas,
il est vrai, les inconvénients de cette tentative pour les savants qui font
l’histoire de l’irlandais : instituer par l’école et par le livre un irlandais
commun, c’est ruiner les témoignages sincères qu’apportent, sur le passé de
l’irlandais, les parlers qui ont survécu par eux-mêmes… Mais à juger des choses
en homme civilisé, en Européen, à se placer au point de vue pratique, il est
étrange qu’on puisse même proposer à un peuple d’abandonner la grande langue de
civilisation, largement ouverte sur le monde qu’est l’anglais, pour un parler de
paysans qui l’emprisonnerait dans un cachot linguistique » (Les langues dans
l’Europe nouvelle, avant-propos de la 2e éd., p. x). L'homme qui écrivait
ces lignes avait lui-même fait le très difficile apprentissage du
vieil-irlandais auprès du grand d'Arbois de Jubainville ; mais, trait révélateur
de sa conscience d'Européen du XXe siècle, il séparait de la vie moderne ce
qu'il regardait comme une sorte d'archéologie linguistique.
À ce mal inévitable Meillet proposait un remède, qui n'a guère été suivi : le
recours aux langues classiques, ou plus exactement au fonds intellectuel commun
qu'elles représentent pour l'ensemble de la culture européenne. Car, réaliste,
il n'aurait sans doute pas cautionné l'entreprise du « latin vivant », pas plus
qu'il n'avait réellement appuyé les essais de langues artificielles.
Mais ses
recherches sur des idiomes parfois très éloignés (il a été l'un des premiers
déchiffreurs du tokharien d'Asie centrale) n'ont jamais détourné Meillet de son
attachement aux grandes langues
classiques. Il avait des littératures anciennes une lecture étendue, constamment
entretenue, qui allait d'Homère à Cicéron. Son célèbre
Aperçu
d'une histoire de la langue grecque
(1re éd. 1913), qui a, on l'a vu, attiré d'emblée l'attention d'un
non-helléniste comme Lucien Febvre, a été salué comme un chef-d'œuvre par Alfred
Croiset ; il allait décider le jeune Dumézil, alors lycéen, à poursuivre des
études de lettres. Si l'Esquisse
dédiée au latin (1928) peut paraître moins achevée, moins équilibrée, elle reste
éminemment suggestive : le vieil esprit romain, saisi à travers sa langue et sa
première littérature, puis la manière dont il s'imprègne de culture grecque pour
en répandre le meilleur et ainsi assurer durablement le prestige du latin en
Europe, y sont caractérisés en des formules saisissantes. Ces deux livres ont
été récemment réédités dans une forme rajeunie et sont toujours en vente. Et
l'on ne saurait oublier que son dernier livre, composé avec Alfred Ernout, est
ce Dictionnaire étymologique
qu'on ne cesse de remettre à jour et qui a servi de modèle à des entreprises
parallèles. Associé dès ses débuts à l'Association G. Budé (1917), il en est
resté administrateur jusqu'au bout, rendant compte de ses éditions, y apportant
à l'occasion l'appoint de sa science d'helléniste ; sans l'accident brutal qui
devait entamer son activité, il aurait en partie présidé son congrès de Nîmes à
Pâques 1932.
Faut-il s'étonner de le voir occuper le
poste de président de la Société des études latines dès la quatrième année de sa
fondation, tout de suite après les aînés Havet, Chatelain, Gœlzer ? soutenir aussi J. Marouzeau dans sa lourde tâche bibliographique, pénétré qu'il était de
la nécessité, pour un linguiste, de ne négliger ni littérature, ni civilisation,
et regrettant, en parcourant l'Année philologique, d'avoir l'impression
de visiter
« un cimetière d'enfants mort-nés » ?
Il voyait dans l'héritage gréco-latin le
fondement, non seulement historique, mais la source vive de la civilisation
européenne. Car,
insistait-il, ce ne sont pas seulement les grandes nations de langues romanes
qui portent en elles cet héritage, mais la civilisation d’Occident tout entière,
chaque nation se l’étant assimilé et l’ayant adapté à mesure de son accession à
la culture méditerranéenne ou, plus tard, au christianisme, jusqu’à ce que la
Renaissance vienne le raviver, inaugurant le processus qui devait conduire aux
révolutions technologiques contemporaines. En dehors des langues romanes, qui ont conservé la
matérialité des mots latins dont elles ont hérité − et mis à part l’anglais qui
a reçu nombre de mots du français −, toutes les langues de l’Europe
occidentale, et notamment germanique, ont vu leur vocabulaire philosophique,
moral ou scientifique, et même leur syntaxe, enrichis, affinés par des clercs ou
par des humanistes qui savaient le latin et qui y ont fait passer des notions,
des valeurs, des nuances puisées au fonds latin. Ces mêmes éléments, du reste,
étaient souvent, en latin même, et par une opération semblable, empruntés à la
tradition grecque : c’est ainsi que le grec
aitía
communique son sens philosophique de « cause »
au latin causa, et ce dernier à l’allemand Sache, Ursache ; que
l’allemand Gewissen « conscience » est construit exactement comme lat.
conscientia, ou qu’il emprunte Qualität à un lat. qualitas
formé lui-même par Cicéron sur le modèle de gr.
poiótēs,
etc. Cicéron avait ainsi enrichi la langue latine de valeurs grecques, pour
faire du latin un instrument de la pensée universelle qui devait survivre plus
de mille ans à l’effondrement de l’Empire d’Occident ; aussi Meillet le
considérait-il comme l’un des fondateurs de la civilisation européenne. Ainsi,
l'allemand est tout pénétré de latin, a-t-il écrit maintes fois : « il n('y)
subsiste de germanique que les moyens matériels d'expression ; toute la face
sémantique est latine ou romane » (Les langues..., p. 266). Combien il
aurait été scandalisé d'entendre, comme le signataire de ces lignes, un
contemporanéiste connu proclamer devant une Faculté que le bagage indispensable
à un germaniste en matière d'Antiquité romaine se limite à la bataille de
Teutoburg !
Aussi n’est-ce pas un
hasard si ces idées formaient le fond de conférences faites à Berne et à
Prague : dans deux pays dont les langues ont été artificiellement « vernacularisées » par des nationalismes intransigeants. La Tchécoslovaquie a
été, en effet, l'un des États qui ont déployé le plus d'efforts pour dissimuler
par un vêtement national l'unité profonde du vocabulaire européen, qui tient
tout entière dans son héritage gréco-romain : en appelant divadlo ce qui
partout ailleurs en Europe (même en Russie) et en Amérique est adapté de
théatron, les intellectuels tchèques ont inutilement contribué à isoler leur
langue du concert international. De même l'allemand, qui traduisait par
Fernsprecher ce qu'on nomme partout ailleurs « téléphone ». Si
Meillet concédait que l'étude du grec est pénible, il tenait du moins pour
indispensable le maintien du latin, qui a d'ailleurs souvent pris au grec ce qui
devait passer dans le bien commun du vocabulaire de civilisation européen : « l’étude du latin, que menace l’esprit égalitaire des démocraties et qui apparaît souvent comme un
pur luxe, est de grande portée ; si elle n’a plus la valeur pratique immédiate
qu’elle avait au Moyen Age et qu’elle a longtemps conservée, elle est
indispensable pour maintenir entre les langues modernes un reste d’unité » (Les
langues..., p. 266). Il ajoutait que le jour où l'on abandonnerait
les études latines, on amoindrirait la capacité de résistance des langues
romanes elles-mêmes : « ce n'est qu'en se rattachant toujours à leurs origines
latines qu'(elles) pourront faire bloc entre elles », et d'insister sur la
valeur d'instrument pédagogique du latin pour passer d'un idiome à l'autre (ibid.,
p. 265).
Qui ne voit ce que ces lignes avaient de prophétique, à présent que l'anglais ne
s'impose pas seulement comme la
langue internationale, mais encore pénètre nos propres langues dans le lexique
(formes et sens), voire se substitue à elles au sein de nos propres
entreprises ?
Sur
un plan plus
large, Meillet a pu souhaiter voir se réaliser ce qu’on appelait alors les
États-Unis d’Europe, préfiguration de ce qui devait être vingt ans plus
tard notre C.E.E. Cette vaste confédération, il la voyait lointaine, mais
nécessaire pourtant. Il écrivait à la fin des Langues… « chacune des
démocraties nationales doit sentir qu’elle est une partie d’une humanité dont
l’unité apparaît chaque jour plus évidente et qui n’a de plus en plus qu’une
civilisation, héritière de la civilisation gréco-romaine, et elle doit faire le
nécessaire pour s’entendre avec toutes les autres » (p. 287).
On sait, hélas, ce
qu'il est advenu. Les divers totalitarismes, nationalistes ou non, qui ont plus
tard consacré l'échec des démocraties de 1920 n'ont que trop confirmé le
scepticisme voilé dont s'enveloppait la conclusion de ce beau livre quant à la
réalisation de ces vœux.
Meillet a pu, vers la fin de sa vie, éprouver le chagrin d'assister à l'exploitation
politique faite par une certaine Allemagne de ce qui avait fondé sa propre
carrière : la parenté des langues indo-européenne, dont l'évidence s'était muée
en une effrayante théorie raciste ; alors que les forces commençaient à lui
manquer, il a du reste tenu à la dénoncer lui-même publiquement lors du suicide,
en 1933, du linguiste Hermann Jacobsohn (Bull. Soc. de linguist.,
34, p. xxiv-xxv). La science, chez lui, n'allait pas sans conscience.
Mais la roue tourne.
Une Europe unie se réalise.
Le hasard a voulu que
le centenaire
de la nomination de Meillet
au Collège de France, l'année 2006, ait
coïncidé avec l'entrée dans l'Union de pays dont aucun ne devait lui être
indifférent. Avec la
Roumanie, pays longtemps divisé et que sa position géo-stratégique tenait éloigné de nous, achevait ce regroupement des nations latines qu'il avait appelé de
ses vœux dès 1920. La Bulgarie
est
le creuset où, avec la Macédoine, s'est élaborée cette vieille langue ecclésiastique,
première forme écrite du slave, qui fournissait à Meillet le sujet de sa thèse
principale, et dont l'action sur les vernaculaires de l'Est et du Sud s'est
révélée si durable que, par un piquant paradoxe, le nom tout révolutionnaire de Leningrad en conservait la marque.
Et s'il reconnaissait un mérite à
la civilisation byzantine, c'est bien d'avoir
transmis aux nations
slaves une part de l'héritage hellénique, perceptible jusque dans la littéralité
avec laquelle Cyrille et Méthode ont rendu le grec des Évangiles. Il eût été plus heureux encore, peut-on croire, de voir la
république grecque de Chypre (il écrivait Cypre, en réaction contre
cette orthographe vieillotte issue des Croisades) retrouver, après une
très longue séparation, le domaine continental où la civilisation gréco-romaine s'est
principalement épanouie : n'est-ce pas la grande île d'Aphrodite, d'où est venu
à notre Occident son nom du cuivre, qui a maintenu le plus longtemps le
vieil idiome achéen, l'écrivant encore au 1er millénaire avant le Christ dans le
syllabaire hérité des temps héroïques ?
Si donc à maints égards l'Europe d'aujourd'hui apparaît plus conforme à ce que
Meillet avait pressenti, souhaité et conseillé, il est trop évident, d'une part,
que les crispations nationalistes n'en ont pas tout à fait disparu
–
c'est peu dire si
l'on songe à la défunte Yougoslavie –,
et d'autre part, que
c'est désormais l'anglais, non le latin, qui représentera (de manière assez
sommaire, il est vrai, mais voyante) l'héritage linguistique gréco-latin. Du
moins lui sert-il de vecteur dans le Monde entier, l'étendant à des continents
dont l'Antiquité ignorait l'existence. Et ce ne serait pas le chapitre le moins
saisissant à ajouter à l'Esquisse
que celui qui montrerait un homme d'affaires chinois, un diplomate du Moyen
Orient, un chercheur nigérian faire, par le truchement de l'anglais, et avec
leurs habitudes articulatoires respectives, un usage quotidien de mots latins à
peine déformés sous leur apparence écrite, et que reconnaîtraient sans trop de
peine Cicéron ou saint Augustin. Habent sua
fata quoque linguae.
FEC - Folia Electronica Classica
(Louvain-la-Neuve) - Numéro 14 - juillet-décembre 2007
<folia_electronica@fltr.ucl.ac.be>